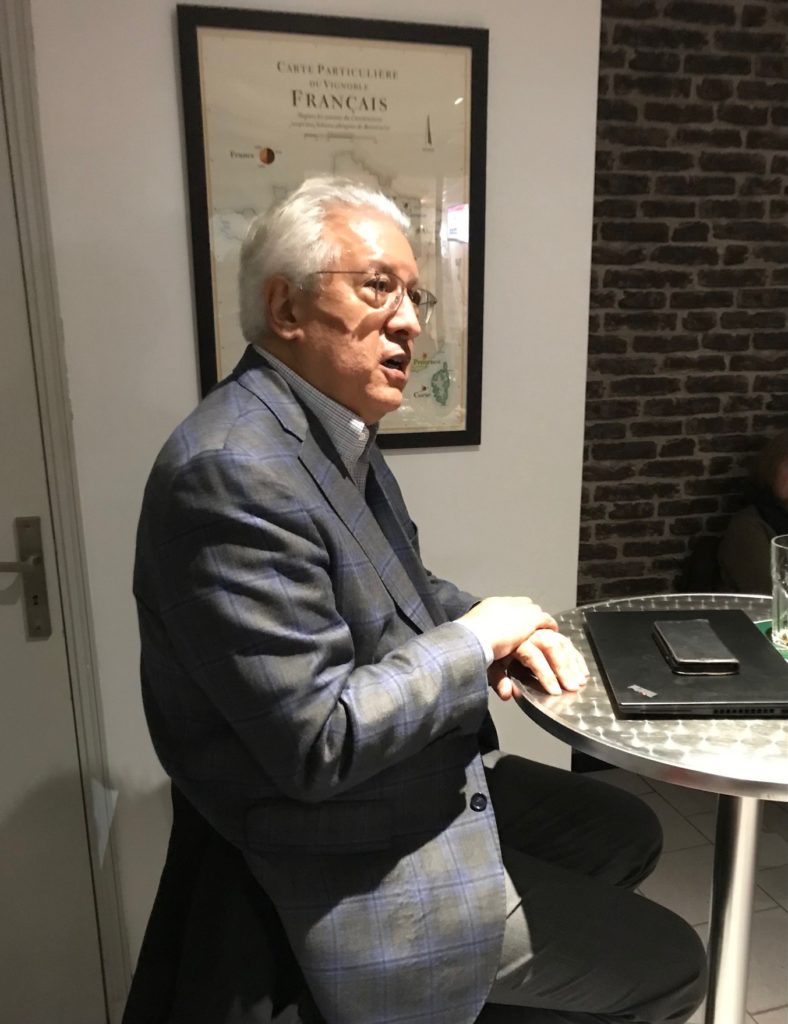 Le prochain café philosophique, consacré à Hegel (1770-1831), sera présenté par Jean-Paul Tran Thiet, avocat, philosophe de formation :
Le prochain café philosophique, consacré à Hegel (1770-1831), sera présenté par Jean-Paul Tran Thiet, avocat, philosophe de formation :
Hegel fait partie des philosophes dont la lecture est difficile. Mais sa pensée est puissante et diversifiée, non seulement sur les fondements de la sagesse et de la Science (thèmes de son œuvre majeure la phénoménologie de l’Esprit) mais aussi sur l’esthétique ou le droit.
Dans la préface de Principes de la philosophie du Droit, il a écrit l’une de ses phrases les plus célèbres : « ce n’est qu’au début du crépuscule que la chouette de Minerve prend son envol ».
Que signifie cette phrase qui évoque la chouette de Minerve, oiseau de la Sagesse et de la Raison, à laquelle fait écho la Chouette Noizéenne ? Hegel a-t-il seulement voulu souligner que le temps de l’action et celui de la réflexion doivent être séparés ? Ou considère-t-il aussi qu’il existe un « raison » dans l’Histoire ?
C’est ce que nous essaierons de définir lors de notre rencontre du 4 novembre
Jean-Paul Tran Thiet
Le 4 novembre à 18h30, café restaurant La bonne franquette
