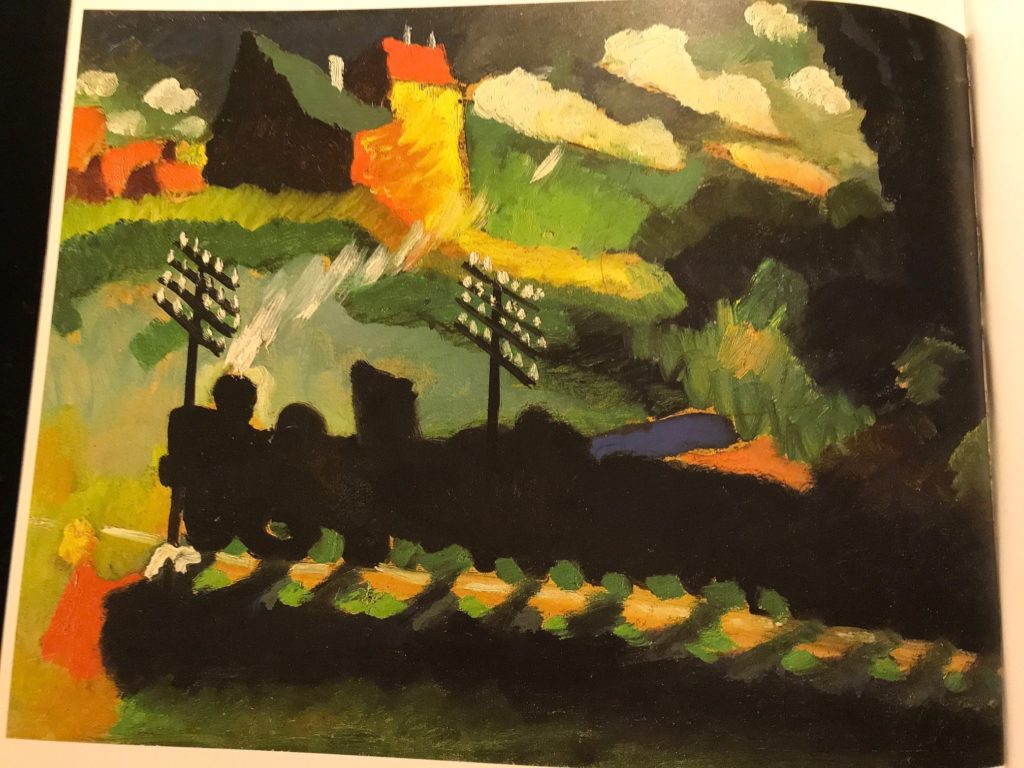Le 7 décembre nous examinerons les thèses audacieuses de Montesquieu (1689-1755). Précurseur de la sociologie et de l’anthropologie, il fut le premier à s’intéresser aux cultures et systèmes politiques de sociétés hors de l’Europe, et en les comparant à élaborer une théorie des régimes politiques. Leur variété s’expliquerait par la différence entre les climats, la superficie des territoires, la répartition de l’habitat, et autres facteurs. La forme prise par l’Etat (république, monarchie, despotisme) résulterait de l’adaptation à ces conditions. Cela ne conduit-il pas à une sorte de déterminisme, par exemple le lien entre vaste territoire et despotisme ?
L’autre apport de Montesquieu est plus connu : la nécessaire séparation des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) pour éviter le despotisme, avec des indications très précises sur la façon d’établir l’équilibre entre les institutions. Le plus intéressant est son jugement sur la fragilité des démocraties, menacées par la corruption lorsque « l’esprit d’égalité extrême » agite le peuple et conduit à l’anarchie. Nombre de ses analyses semblent avoir été écrites pour la France actuelle…
Jeudi 7 décembre à 18h30, café-restaurant La Bonne Franquette, 39 rue de la République à Noizay
Suggestions de lecture :
« De l’esprit des Lois », édition Garnier Flammarion, un gros ouvrage en deux volumes, dense et plutôt ardu.
« Lettres persanes », même éditeur, présente sous forme romancée et concrète l’essentiel des analyses de Montesquieu. Ouvrage disponible à la bibliothèque de l’association (prêt réservé aux adhérents)